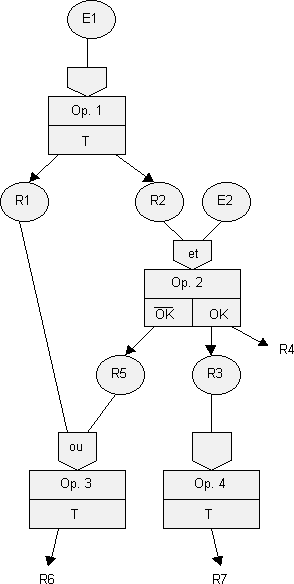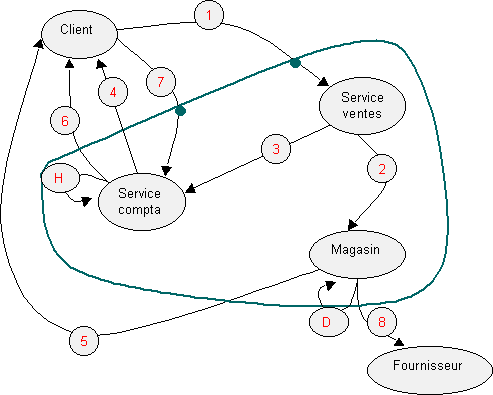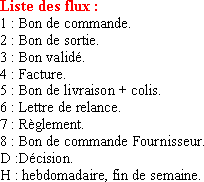On notera les évènements E1, E2, E3, ... Les opérations
sont notées Op.1, Op.2, ... et les résultats sont marqués
R.
 Les
évènements : qu'ils soient externes ou internes, il peut
y avoir de 1 à n évènement déclenchant un processus
ou une opération. Tout processus commence par un évènement
soit externe, soit interne répondant à une de ces deux caractéristiques
:
Les
évènements : qu'ils soient externes ou internes, il peut
y avoir de 1 à n évènement déclenchant un processus
ou une opération. Tout processus commence par un évènement
soit externe, soit interne répondant à une de ces deux caractéristiques
:
 Temporisation
(Ex : fin de mois, à une heure donnée,
...)
Temporisation
(Ex : fin de mois, à une heure donnée,
...)
 Décision
(comme dans le M.C.C.).
Décision
(comme dans le M.C.C.).
Les flèches arrivant aux opérations sont notées
:
On peut très bien avoir plusieurs conditons à l'entrée
d'une opération (Ex : Rx et (Ry ou
Rz)).
 Les
opérations : elles consistent en un ensemble de traitements
élémentaires à effectuer sur les évènements
arrivant, en lui ajoutant une valeur abstraite ou concrète.
Les
opérations : elles consistent en un ensemble de traitements
élémentaires à effectuer sur les évènements
arrivant, en lui ajoutant une valeur abstraite ou concrète.
La partie supérieure de l'opération est une description de
cet ensemble de tâches. La partie inférieure correspond à
une règle d'émission des résultats :
Dans ce cas aussi, il se peut qu'il y ait des règles d'émission
de résultats complexes.
 Les
résultats : ils sont une valeur ajoutée au(x) flux entrant
de l'opération et peuvent être de deux types diférents
:
Les
résultats : ils sont une valeur ajoutée au(x) flux entrant
de l'opération et peuvent être de deux types diférents
:
 Valeur
concrète : un nouvel objet est créé. (Ex
: R1, R2, R3, R5).
Valeur
concrète : un nouvel objet est créé. (Ex
: R1, R2, R3, R5).
 Valeur
abstraite : mise à jour d'un flux entrant (Ex
: R4, R6, R7).
Valeur
abstraite : mise à jour d'un flux entrant (Ex
: R4, R6, R7).
Il est à noter que les résultats peuvent devenir des évènements
pour les opération suivantes (Ex :
R1, R2, R3, R5).
Le M.C.T. a pour but de construire tous les processus, or si nous n'analysons
que le M.C.C. on se rend compte que nous n'avons étudié que
les processus sur les flux. Il faut reprendre le M.C.D. (si on dispose
de celui-ci) et repérer les invariants, sur lesquels on ne
dispose pas de processus de gestion. Dans l'exemple que nous avons traité
ici, on ne possède pas de processus sur la gestion des clients.
Il faut donc faire le M.C.T. sur l'invariant CLIENT.
Le M.C.T. sur invariant est constitué de quatre parties :
 Création
: Il faut notifier le mode de création de l'identifiant (manuel,
automatique, semi-automatique), les éléments obligatoires
en cas de création, les éléments facultatifs et les
conditions de création.
Création
: Il faut notifier le mode de création de l'identifiant (manuel,
automatique, semi-automatique), les éléments obligatoires
en cas de création, les éléments facultatifs et les
conditions de création.
 Suppression
: Il faut préciser ce qui est supprimé, les conditions
de suppression, s'il y a une trace de la suppression ou non.
Suppression
: Il faut préciser ce qui est supprimé, les conditions
de suppression, s'il y a une trace de la suppression ou non.
 Consultation
: Il faut spécifier les critères d'accès, et ce
que l'on peut consulter ou pas.
Consultation
: Il faut spécifier les critères d'accès, et ce
que l'on peut consulter ou pas.
 Modification
: Il faut préciser les modes de suppression (individuel, global,
mixte), et prévoir les conséquences des modifications (voire
même insérer une date d'effet pour certaines modifications).
Modification
: Il faut préciser les modes de suppression (individuel, global,
mixte), et prévoir les conséquences des modifications (voire
même insérer une date d'effet pour certaines modifications).